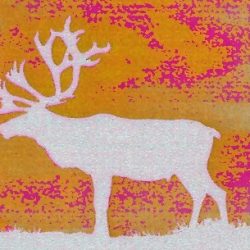Petit pays (2016), Gaël Faye
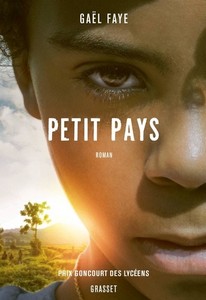
Gaël Faye est né en 1982, d’abord connu comme chanteur, auteur-compositeur interprète, est reconnu aujourd’hui comme écrivain. Petit Pays est son premier roman, largement autobiographique, d’une très belle écriture.
Son protagoniste est un enfant de dix ans Gabriel qui vit au Burundi dans une famille mixte, aisée. Il a une vie agréable, protégée, jusqu’au moment où il est pris dans la tourmente de l’Histoire qui envahit sa vie, par vagues de violence successives, de plus en plus rapprochées et qui va le pousser comme des milliers d’autre à l’exil.
C’est un livre qui parle donc de l’exil : celui du narrateur, Gabriel du Burundi en France et celui de sa mère et de sa famille du Rwanda au Burundi :
« Je n’habite nulle part. Habiter signifie se fondre charnellement à la topographie d’un lieu, l’anfractuosité de l’environnement. Ici, rien de tout ça. Je ne fais que passer. Je loge ? Je crèche. Je squatte. »
Dans la famille de sa mère, il y a la grand-mère qui a la nostalgie du pays perdu qu’elle raconte sans cesse et il y a le petit fils Pacifique qui rêve du pays à venir, réuni et qui sera pris par la tourmente.
C’est un livre de l’horreur des massacres Hutus et Tutsis dans les deux pays. Le narrateur cherche subtilement des failles dans la vie d’avant, au Burundi, où régnait l’illusion d’une vie commune possible dans ce pays cosmopolite.
– c’est un pays où cohabitent des Tutsis, des Hutus, des Zaïrois (qui peuvent être Hutus ou Tutsis), des Twas, des Pygmées, des Européens vestiges de la colonisation. Il y a des mariages « intercommunautaires » comme la famille du narrateur, mais cependant, on identifie, on désigne l’autre avant que les rivalités se cristallisent.
– Les distinctions apparaissent entre les Burundais et les autres (Innocent), entre les Blancs et les autres : les Blancs ont hérité de la colonie une idée de leur supériorité et le racisme est à fleur de mots même chez ceux qui ont épousé des Noires. Le père qui aime sa femme, son pays qu’il a à cœur de faire découvrir et aimer à son fils a des relents racistes inconscients. Les Burundais n’apprécient guère les Blancs et les femmes noires qui les ont épousées.
– Il existe des oppositions Capitale (Bujumbura) / campagne épisode du vélo ou de la circoncision
– Ces deux dernières recoupent des oppositions de classes : les Blancs forment une classe supérieure. Ils méprisent les subalternes (la mère s’adresse aux employés par des phrases sans verbe). La scène de récupération du vélo chez des paysans pauvres est très violente et on y voit un des employés du côté du patron.
Il met aussi en exergue les effets de groupe sur générateurs d’une grande violence :
– les villageois qui organisent une chasse à l’homme contre le voleur initial du vélo et le lynchent
– la bande d’enfants de l’impasse qui refuse l’intrusion sur leur domaine et qui se crispe avec la montée de la peur
« Je me demande encore quand les copains et moi avons commencé à avoir peur »
Et puis il y a l’explosion indicible de la violence dont l’histoire nous est détaillée. Elle est comparée à un moment aux catastrophes naturelles fréquentes dans ces lieux situés sur le Rift Africain, grande zone sismique et volcanique :
« Les hommes de cette région étaient pareils à cette terre. Sous le calme apparent, derrière la façade des sourires et les grands discours d’optimisme, des forces souterraines obscures travaillaient en continu, fomentant des projets de violences et de destruction. »
Personne ne peut échapper à la tourmente Même les plus pacifistes comme notre héros sont obligés de choisir leur camp, de se mouiller, de tuer. Ceux qui échappent eux-mêmes aux tueries sont confrontés à celles de leurs proches et sombrent dans la folie. L’exil permet un peu la mise à distance mais aussi la lecture où s’immerge le narrateur grâce à la voisine grecque.
Dominique Dor.